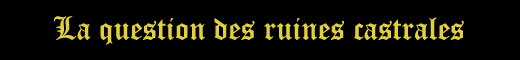|
Quoi de plus fascinant qu'un château fort?
Des simples cavernes aménagées aux gratte-ciels démesurés, du chalet de montagne à la cathédrale gothique,
la structure conçue par l'homme pour l'acueillir et l'héberger a toujours occupé dans son histoire (et dans son coeur) une place prépondérante.
Etant à la fois refuge, défense, expression du désir de confort, recherche de la beauté et de la grandeur,
ce cadre de vie (matérielle et parfois spirituelle) qu'est le bâtiment nous "parle" en effet autant qu'il possède la faculté de "parler de l'homme".
C'est que l'architecture, au confluent de ce que dicte la nécessité vitale la plus impérative et de ce qu'inspire la recherche de la création esthétique la plus libre, est, entre technique et art, une discipline de fait particulièrement "humaine".
/contre-jour_eguisheim.jpg)
Le Château Fort a cela de fascinant qu'il représente quelque part une synthèse de ces différents agents qui amènent l'homme à modeler son environnement pour ériger des demeures, des édifices aux fonctions déterminées.
Il est à la fois:
- demeure guerrière, forteresse élevée dans le but de repousser les assaillants et de protéger ses habitants
- palais luxueux, demeure seigneuriale dont le confort de l'aménagement interne se doit d'égaler la sécurité des fortifications
- symbole de puissance, édifice glorieux, représentatif de la valeur et la grandeur de ses hôtes ainsi que de leur ascendance sur les sujets
- oeuvre d'art, création harmonieuse composant la pierre et les autres matériaux pour qu'à la majesté de l'édifice s'ajoute l'élégance, l'harmonie, l'audace, la singularité...
Le château fort est ainsi une réalisation dont la richesse tire ses trésors dans les différentes facettes de l'âme humaine, tour à tour défensive, belliqueuse, technicienne, prétendante à la puissance et la grandeur, esthète, contemplative...

Le château ruiné: perte pour la connaissance mais beautés et charmes nouveaux
Ce que l'Alsace nous offre à contempler, ce ne sont pas des châteaux conservés, intacts, témoins fidèles de ce qu'ils furent par le passé.
Ce sont des ruines de châteaux dont les vestiges ne nous livrent que des bribes, des fragments d'histoire, de mémoire... des courtines amoindries, des donjons écorchés et des pierres éparses, lavées par la pluie et dipustées par la végétation, la nature qui reprend ses droits.
De ces ruines pourtant émane un charme nouveau, un chant des siècles, une âme, qui dépassent le cadre d'étude archéologique et historique dont elles peuvent être le lieu.
Le lierre, les arbustes, les fissures, les éboulis, toutes ces parures et blessures qui écartent les ruines de leur appartenance à la civilisation et à la société des hommes leur ouvrent les portes du rêve, de l'imaginaire, du merveilleux.
A l'attention portée à la fonction et la réalisation de telle ou telle section ou élément du château, peut s'ajouter ou se substituer celle portée à sa forme, sa couleur, ses jeux d'ombres lorsqu'elle joue avec le soleil et ses jeux de mouvement lorsque le vent anime les plantes qui la bordent et la ponctuent.
Mystère, poésie, mystique...
Par tous les temps et à toutes les heures du jour, de l'aurore au crépuscule, la magie de la ruine comble le promeneur solitaire qui sait être sensible au langage des pierres.
Lorsque ces dernières anciennement taillées mais tombées à terre, font montre d'un lent mais implacable "mimétisme" à l'égard de leur "consoeurs naturelles"...
La pierre et la plante s'enchevêtrent et s'interpénètrent en la ruine de même que la curiosité, le désir de la connaître et de la comprendre convole en nous avec l'imagination et le rêve suscité par la féerie du lieu.
Comment le château a-t-il été edifié? Qui étaient ses habitants, à combien de siège a-t-il resisté?
Aux interrogations sérieuses et nécessitant des analyses et des recherches rigoureuses ne peuvent manquer de s'adjoindre les fantasmes d'épiques et colorés tableaux imaginaires où se côtoient tour à tour chevaliers belliqueux, princesses galantes et ménestrels mélancoliques...
Leur éloignement des foyers de population, la majesté avec laquelle elles surplombent la plaine rhénane du haut de leurs dénivelé vosgien, la manière dont elles se cachent dans les fôrets revenues jusqu'à elles,
tous ces caractères de distance, de hauteur et d'abandon confèrent au ruines castrales vosgiennes une dimension fantastique, un "supplément d'âme" qui leur autorise une chimérique familiarité avec d'hypothétiques elfes, fées, enchanteurs, à moins que ce ne soit des prêtres mystérieux ou des brigands...
Les ruines sont un chantier d'étude, une mine de renseignements sur notre histoire, les moeurs de nos ancêtres, les évolutions politiques, techniques et esthétiques de notre civilisation.
Mais elles sont bien plus que cela encore: Elle sont le lieu d'une âme. Une âme qu'elles doivent à leur capacité à interpeller l'imagination, à émaner le fantastique et le mystère.

Charme éphémère et restaurations "désenchanteresses": le commencement du dilemme
les châteaux les plus beaux sont souvent les plus sauvages. Mais les châteaux les plus sauvages sont souvent les plus menacés: pour avoir traversé les siècles jusqu'à nous, les ruines n'en sont pas moins sujettes à des dégradations et des destructions peut-être discrètes mais continuelles et qui amèneront ineluctablement à leur disparition si rien n'est entrepris pour y rémédier.
C'est pour cette raison que se constituent des associations cherchant à promouvoir la sauvegarde, la restauration, la sécurisation et la mise en valeur des ruines.
Mais les travaux opérés sur les ruines posent certains problèmes:
- le problème de la nécessité de sécuriser le lieu pour éviter les accidents du type chute (de pierre ou de touriste imprudent)
- le problème du coût de la restauration et de la sécurisation (problème central, bien entendu...)
- Le problème de la fidélité de la restauration à l'édifice originel
- le problème de "l'aseptisation" d'une ruine trop bien nettoyée et "raccomodée". Pour pousser à l'extrême (l'exagération est consciente),La végétation qui les mets en périls participe au charme des ruines, ainsi que les lézardes dans les murs, en réparer ou sécuriser la ruine ampute immanquablement une partie de ce qui fait son charme.
Les édifices en instance d'éboulement, comme le donjon du Lutzelbourg à Ottrott, dégagent un charme singulier que viendraient ternir et amenuiser le réajustage des pierres et l'adjonction de mortier...
- le problème de l'accessibilité et de la fréquentation de la ruine. L'entrée doit-elle être payante (notamment pour financer les travaux de restauration)? La ruine peut-elle devenir un cadre privilégié pour des manifestations culturelles ou risque-t-elle d'y perdre son âme? Faire connaître les châteaux au plus grand nombre est certainement une bonne chose (et la garantie de trouver les fonds nécessaires aux travaux), mais cela amène aux ruines des gens irrespectueux du lieu, et cela peut encourager une exploitation commerciale incompatible avec la préservation et la sauvegarde de son charme.
Conclusion (provisoire)
Je ne fais ici qu'esquisser des pistes de reflexions sans faire état d'un point de vue arrêté sur ces questions. Mais si il n'existe pas de "remède miracle", de solution à même de contenter tout le monde sur ces questions épineuses, la vérité réside sans doute dans une sagesse "médiane", une attitude raisonnée au carrefour des considérations économiques, scientifiques, et artistiques, ainsi qu'une considération individuelle du cas particulier que représente chaque ruine.
Le plus important dirais-je, est d'aimer les ruines. En poète, en historien, en architecte, en botaniste, peu importe, la vérité de chacun n'est pas superposable et "additive", alors que l'amour qu'il porte aux ruines l'est.
Gabriel GEHENN
lundi 16 juillet 2001
|